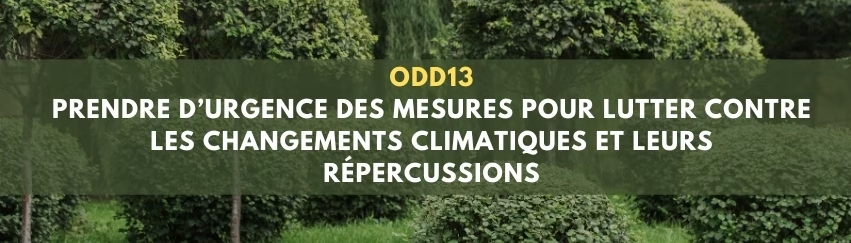Chapitre 15 : Gestion de la Végétation Compétitrice : Désherbage et Maîtrise de la Concurrence
La gestion de la végétation compétitrice est un véritable levier de succès pour assurer la reprise et la croissance vigoureuse des jeunes arbres. Votre chapitre 15 est donc crucial pour comprendre et mettre en œuvre des stratégies efficaces. Développons ensemble les méthodes de désherbage et les techniques de maîtrise de la concurrence :
Gestion de la Végétation Compétitrice : Désherbage et Maîtrise de la Concurrence
I. La Végétation Compétitrice : Un Frein Majeur à la Croissance des Jeunes Plants
Vous avez parfaitement identifié le problème : la végétation spontanée peut devenir une rivale redoutable pour les jeunes arbres. Imaginez une course : les jeunes plants, fragiles et encore peu développés, se retrouvent en compétition avec des plantes souvent déjà bien installées et plus robustes. Cette compétition se joue sur plusieurs fronts :
- Course à la Lumière : Les herbes hautes, les broussailles et les jeunes arbres à croissance rapide peuvent ombrager les jeunes plants, réduisant la lumière indispensable à la photosynthèse et donc à leur croissance. C’est comme si on privait un enfant de soleil : il ne pourrait pas bien grandir !
- Accaparement de l’Eau : La végétation concurrente, souvent dotée d’un système racinaire étendu et superficiel, absorbe l’eau du sol avant que les racines des jeunes arbres ne puissent l’atteindre. En période sèche, ce manque d’eau peut être fatal.
- Ponction des Nutriments : De la même manière, les plantes concurrentes captent les éléments nutritifs (azote, phosphore, potassium…) présents dans le sol, laissant peu de ressources pour les jeunes plants, essentiels à leur développement initial.
- Occupation de l’Espace : La densité de la végétation peut étouffer physiquement les jeunes plants, limitant leur aération, favorisant l’humidité et donc le développement de maladies, et entravant leur croissance mécanique.
- Guerre Chimique (Allélopathie) : Certaines plantes libèrent des substances chimiques dans le sol qui peuvent inhiber la germination et la croissance des autres espèces, y compris les jeunes arbres. C’est une forme de compétition invisible mais bien réelle.
En bref, la végétation compétitrice crée un environnement hostile pour les jeunes plants, ralentissant leur croissance, augmentant leur vulnérabilité et pouvant mener à des taux de mortalité élevés. La gestion de cette concurrence est donc primordiale pour garantir le succès de la reforestation.
II. Méthodes de Désherbage : Un Arsenal d’Outils Adaptés
Pour faire face à cette compétition, différentes méthodes de désherbage existent. Chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients et son application privilégiée selon le contexte.
A. Le Désherbage Manuel : Précision et Douceur pour les Petites Surfaces
Le désherbage manuel est la méthode la plus traditionnelle et la plus respectueuse de l’environnement. Elle consiste à enlever la végétation indésirable à la main ou avec des outils manuels simples.
-
Techniques :
- Arrachage manuel : Tirer les herbes à la main, idéalement en enlevant les racines pour limiter la repousse.
- Binage : Utiliser une binette pour couper les racines des herbes juste sous la surface du sol.
- Fauchage manuel : Couper les herbes hautes avec une faucille ou une débroussailleuse manuelle (pour dégager les plants).
- Débroussaillage manuel : Couper les broussailles avec un sécateur, une scie ou une hache (pour dégager des zones plus envahies).
-
Avantages :
- Sélectivité : Permet de cibler précisément les plantes à éliminer, en préservant les espèces souhaitables (plantes compagnes, espèces de sous-bois…).
- Écologique : N’utilise aucun produit chimique, respecte le sol, la faune et la qualité de l’eau.
- Adapté aux terrains difficiles : Peut être pratiqué sur des pentes, des zones rocailleuses ou accidentées.
- Peu coûteux en matériel : Nécessite des outils simples et abordables.
- Créateur d’emplois : Intensif en main-d’œuvre, il peut générer de l’emploi local.
- Idéal pour les petites surfaces et les plantations denses.
-
Inconvénients :
- Très exigeant en main-d’œuvre : Lent, fatiguant et difficilement réalisable sur de grandes surfaces.
- Peu efficace contre certaines espèces : Moins efficace contre les plantes vivaces à racines profondes ou celles qui se reproduisent par rhizomes.
- Nécessite des interventions répétées : La végétation a tendance à repousser, il faut donc renouveler le désherbage régulièrement.
- Peut devenir coûteux pour les grandes surfaces en raison du coût de la main-d’œuvre.
B. Le Désherbage Mécanique : Efficacité et Rapidité pour les Surfaces Moyennes à Grandes
Le désherbage mécanique utilise des machines agricoles pour travailler le sol ou couper la végétation. Il est plus rapide et moins fatigant que le désherbage manuel, et adapté aux surfaces plus importantes.
-
Techniques :
- Travail du sol superficiel (Binage mécanique, hersage) : Utilisation de bineuses rotatives, de herses étrilles ou de cultivateurs légers tractés par un tracteur ou un motoculteur pour couper les racines des herbes et ameublir le sol en surface.
- Fauchage mécanique : Utilisation de faucheuses à barre de coupe, de girobroyeurs ou de débroussailleuses à roues pour couper les herbes hautes.
- Débroussaillage mécanique : Utilisation de broyeurs forestiers, de tracteurs forestiers équipés de broyeurs, ou de machines spécialisées pour broyer les broussailles, les jeunes arbres indésirables et les rémanents de coupe (branches, souches…).
-
Avantages :
- Rapidité et efficacité : Permet de couvrir des surfaces moyennes à grandes plus rapidement que le désherbage manuel.
- Moins exigeant en main-d’œuvre que le désherbage manuel.
- Coût par hectare généralement plus faible que le désherbage manuel pour les grandes surfaces.
- Peut ameublir le sol : Le travail du sol superficiel peut améliorer l’aération et l’infiltration de l’eau.
- Adapté aux terrains relativement plats et accessibles aux machines.
-
Inconvénients :
- Moins sélectif : Peut endommager ou détruire des plantes souhaitables si le travail n’est pas précis.
- Impact sur le sol : Peut provoquer un tassement du sol, surtout avec des machines lourdes et en conditions humides. Le travail du sol peut perturber la vie du sol.
- Coût d’investissement en matériel : Nécessite l’achat ou la location de machines agricoles.
- Consommation d’énergie fossile : Utilisation de carburant et émissions de gaz à effet de serre.
- Moins adapté aux terrains accidentés et pentus.
- Nécessite parfois des interventions répétées.
C. Le Désherbage Chimique : Efficacité Rapide et Large Spectre, à Utiliser avec Précaution
Le désherbage chimique utilise des herbicides, des produits chimiques conçus pour détruire ou inhiber la croissance des plantes. C’est la méthode la plus rapide et radicale, mais aussi la plus controversée en raison de ses impacts potentiels sur l’environnement et la santé.
-
Techniques :
- Herbicides totaux : Détruisent toutes les plantes (ex: glyphosate). Utilisés avant plantation pour préparer le terrain ou sur des zones non plantées.
- Herbicides sélectifs : Ciblent certaines familles de plantes (ex: herbicides anti-graminées). Utilisés pour désherber sélectivement au sein d’une plantation.
- Application foliaire : Pulvérisation de l’herbicide sur les feuilles.
- Application racinaire : Injection ou application d’herbicide au pied des plantes (pour les souches par exemple).
- Applications manuelles : Pulvérisateur à dos pour les petites surfaces ou les traitements localisés.
- Applications mécanisées : Tracteur équipé de rampes de pulvérisation pour les grandes surfaces.
-
Avantages :
- Efficacité maximale et rapidité d’action : Détruit rapidement et efficacement un large éventail de plantes.
- Adapté aux grandes surfaces : Permet de traiter de vastes zones rapidement.
- Coût par hectare souvent faible pour les grandes surfaces.
- Peut offrir un contrôle durable de la végétation (selon l’herbicide et les espèces ciblées).
-
Inconvénients :
- Impacts environnementaux majeurs :
- Pollution de l’eau et des sols : Risque de contamination des nappes phréatiques, des cours d’eau et des sols par les herbicides et leurs résidus.
- Toxicité pour la faune et la flore non cibles : Impacts sur les insectes pollinisateurs, les vers de terre, les micro-organismes du sol, les plantes sauvages…
- Perturbation des écosystèmes.
- Risques pour la santé humaine : Toxicité potentielle pour les opérateurs, les riverains et les consommateurs (résidus dans l’environnement et potentiellement dans la chaîne alimentaire).
- Développement de résistances : L’utilisation répétée d’herbicides peut entraîner l’apparition de plantes résistantes, rendant les traitements moins efficaces à long terme.
- Image négative auprès du public et réglementation de plus en plus stricte concernant les produits phytosanitaires.
- Nécessite une manipulation et une application très rigoureuses par des opérateurs formés et équipés de protections.
- Impacts environnementaux majeurs :
D. Le Désherbage Biologique : Solutions Naturelles et Durables, mais Plus Délicates
Le désherbage biologique cherche à contrôler la végétation compétitrice en utilisant des méthodes naturelles qui respectent l’environnement. C’est une approche plus douce et durable, mais souvent moins radicale et parfois plus complexe à mettre en œuvre.
-
Techniques :
- Paillage organique : (Voir section suivante) Le paillage est une technique de désherbage biologique efficace.
- Plantes couvre-sol compétitrices : Semer des espèces basses et couvrantes (trèfle, ray-grass…) qui concurrencent les herbes indésirables sans nuire aux arbres.
- Lutte biologique : Introduction d’ennemis naturels des plantes compétitrices (insectes, champignons, bactéries pathogènes spécifiques). Cette méthode est encore peu développée en reforestation.
- Désherbage thermique : Utilisation de la chaleur (flamme, eau chaude) pour détruire les parties aériennes des plantes. Méthode ponctuelle, peu sélective et à utiliser avec précaution (risques d’incendie, impact sur le sol).
- Broyage en surface (Mulching) : Broyer la végétation en surface et laisser les résidus sur place. Cela crée un paillis organique qui freine la repousse et enrichit le sol.
-
Avantages :
- Respectueux de l’environnement et de la santé : Pas de produits chimiques, préservation de la biodiversité et de la qualité du sol.
- Durabilité : S’inscrit dans une logique de gestion durable des écosystèmes.
- Valorisation des ressources locales : Utilisation de paillage organique, de broyat…
- Peut améliorer la fertilité du sol à long terme (avec le paillage et les cultures couvre-sol).
-
Inconvénients :
- Efficacité parfois moins rapide et moins radicale que le désherbage chimique.
- Peut nécessiter des interventions répétées.
- Complexité de mise en œuvre : Demande une bonne connaissance des techniques et des processus écologiques.
- Coût parfois plus élevé pour certaines méthodes (lutte biologique, désherbage thermique).
- Efficacité variable selon les techniques, les espèces ciblées et les conditions locales.
- Peu adapté aux très grandes surfaces pour certaines méthodes.
III. Techniques de Maîtrise de la Concurrence : Agir Durablement
Au-delà du désherbage ponctuel, il existe des techniques de maîtrise de la concurrence qui agissent plus en profondeur et de manière plus durable sur l’environnement des jeunes plants.
A. Le Paillage (Mulching) : Un Allié Multifonctionnel
Le paillage consiste à recouvrir le sol autour des jeunes plants avec une couche de matériaux. C’est une technique simple, efficace et bénéfique à bien des égards.
-
Matériaux Utilisés :
- Paillis organiques : Paille, foin, BRF (bois raméal fragmenté), copeaux de bois, écorces, feuilles mortes, compost, déchets de cultures, mulch de Miscanthus… Ils se décomposent progressivement, enrichissant le sol en matière organique.
- Paillis minéraux : Graviers, pouzzolane, ardoise broyée… Plus durables, ils ne se décomposent pas.
- Paillis synthétiques biodégradables : Films plastiques biodégradables (amidon de maïs, etc.), toiles tissées biodégradables. Moins écologiques que les paillis organiques, mais peuvent être pratiques dans certains contextes.
-
Avantages du Paillage :
- Lutte contre la végétation compétitrice : Empêche la lumière d’atteindre le sol, limitant la germination et la croissance des herbes.
- Maintien de l’humidité du sol : Réduit l’évaporation de l’eau, limitant les besoins en arrosage et protégeant les plants de la sécheresse.
- Amélioration de la structure du sol : Les paillis organiques, en se décomposant, améliorent la texture, l’aération et la fertilité du sol.
- Protection du sol contre l’érosion : Protège le sol de l’impact de la pluie et du vent.
- Réduction des amplitudes thermiques du sol : Maintient une température du sol plus constante, bénéfique pour les racines.
- Esthétique : Peut donner un aspect plus propre et ordonné à la plantation.
-
Inconvénients :
- Coût : L’achat ou la production de paillis peut représenter un coût, surtout pour de grandes surfaces.
- Main d’œuvre : L’épandage du paillis demande du temps et de la main d’œuvre.
- Risque d’abris pour certains ravageurs : Certains paillis peuvent abriter des limaces ou des rongeurs.
- Peut freiner le réchauffement du sol au printemps si la couche de paillis est trop épaisse et sombre.
- Paillis synthétiques moins écologiques que les paillis organiques.
B. Les Cultures Intercalaires (Cultures de Couvert) : Allier Production et Maîtrise de la Végétation
Les cultures intercalaires consistent à semer entre les rangs d’arbres des plantes compagnes qui vont concurrencer la végétation indésirable, tout en apportant d’autres bénéfices.
-
Types de Cultures Intercalaires :
- Légumineuses : Trèfle, luzerne, sainfoin, vesce… Elles fixent l’azote de l’air et l’apportent au sol, enrichissant le milieu pour les arbres.
- Céréales : Avoine, seigle… Elles concurrencent les mauvaises herbes et peuvent être fauchées pour pailler les plants.
- Plantes mellifères : Phacélie, moutarde blanche… Attirent les insectes pollinisateurs et peuvent améliorer la biodiversité.
- Plantes à faible développement : Pour ne pas concurrencer excessivement les jeunes arbres.
-
Avantages des Cultures Intercalaires :
- Maîtrise de la végétation compétitrice : Les cultures intercalaires occupent l’espace et concurrencent les mauvaises herbes.
- Amélioration de la fertilité du sol : Les légumineuses enrichissent le sol en azote.
- Production annexe possible : Récolte de fourrage, de graines, de miel…
- Amélioration de la biodiversité : Attraction d’insectes pollinisateurs et d’auxiliaires.
- Protection du sol contre l’érosion.
-
Inconvénients :
- Compétition potentielle avec les jeunes arbres : Il faut choisir des espèces de cultures intercalaires peu concurrentielles et gérer leur développement (fauche, destruction).
- Complexité de mise en œuvre : Nécessite une bonne planification, un choix judicieux des espèces, et une gestion attentive.
- Coût : Achat de semences, travail du sol pour l’implantation des cultures intercalaires.
- Peut ne pas être adapté à tous les contextes : Certains sols, climats ou objectifs de reforestation peuvent rendre les cultures intercalaires moins pertinentes.
IV. Approches Intégrées : Une Stratégie Globale et Durable
La gestion de la végétation compétitrice ne doit pas se limiter à une seule méthode, mais plutôt s’inscrire dans une approche intégrée qui combine différentes techniques de manière raisonnée et adaptée au contexte. Cette approche vise à :
- Privilégier la prévention : Agir en amont pour limiter le développement de la végétation compétitrice (préparation du sol avant plantation, choix d’essences adaptées au site…).
- Combiner différentes méthodes : Associer désherbage manuel ciblé autour des plants et désherbage mécanique entre les rangs, ou paillage combiné à un désherbage manuel ponctuel, par exemple.
- Adapter les techniques au type de végétation compétitrice : Choisir les méthodes les plus efficaces contre les espèces dominantes (désherbage manuel pour les espèces faciles à arracher, désherbage mécanique pour les grandes surfaces envahies par des herbes hautes…).
- Tenir compte des objectifs de reforestation : Privilégier les méthodes les plus respectueuses de l’environnement dans les projets de restauration écologique, et les méthodes les plus efficaces et économiques dans les projets de production de bois.
- Suivre et adapter : Observer l’évolution de la végétation compétitrice et ajuster les stratégies de gestion en fonction des résultats obtenus et des conditions locales.
En conclusion, la gestion de la végétation compétitrice est une étape incontournable pour réussir une reforestation. Il n’existe pas de solution unique, mais un éventail de méthodes à combiner et à adapter en fonction du contexte. Une approche intégrée, combinant différentes techniques et privilégiant la prévention et la durabilité, est la clé pour maîtriser efficacement la concurrence végétale et favoriser la croissance des jeunes arbres.
La suite de votre document pourrait aborder le suivi et l’évaluation des reboisements, afin de mesurer l’efficacité des actions menées et d’adapter les pratiques pour les projets futurs. N’hésitez pas à partager la suite si vous le souhaitez !